Disparition d’Henri Ciriani (1936-2025)
Architecte et enseignant en architecture engagé, charismatique, reconnu en France comme à l’étranger, Henri Ciriani est décédé dans sa 89e année, le 3 octobre 2025. Il laisse derrière lui un héritage vivant à travers ses œuvres construites et son enseignement qui a marqué plusieurs générations d’architectes.
Difficile de résumer la vie de cet architecte franco-péruvien dont les réalisations et l’enseignement ont marqué le milieu architectural, et au-delà, de la deuxième moitié du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. En France, il a participé activement, avec bien d’autres, à l’effervescence et à l’émulation qui caractérisent l’enseignement et la production post-1968, à une époque de débats intenses et ouverte aux expériences pédagogiques autour de la question du logement, de l’espace architectural et urbain, de la dimension sociale de l’architecture.
Ses années de formation au Pérou, où il est né et a commencé son activité professionnelle, l’ont amené à travailler déjà sur des projets de logements populaires, au sein de l’Instituto Nacional de la Vivienda (Institut national du logement) et de l’agence Ciriani-Crousse-Páez qu’il a cofondée. Quand il arrive en France, en 1964, il intègre l’agence d’André Gomis (1926-1971), investie notamment dans de grands projets d’aménagement urbain et de logements sociaux. En 1968, il rejoint l’Atelier d’urbanisme et d’architecture (AUA), connu pour son fonctionnement coopératif et pluridisciplinaire, au sein duquel il s’associe au paysagiste Michel Corajoud et à l’architecte chilien Borja Huidobro, avant de fonder sa propre agence en 1976. Il réalise alors plusieurs opérations marquantes de logements sociaux comme celle de la Noiseraie à Noisy-le-Grand, dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (1980), la Cour-d’Angle à Saint-Denis (1982) ou encore à Évry-Canal dans la ville nouvelle d’Évry (1986). Par la suite, il réalise également des équipements publics dont l’Historial de la Grande Guerre à Péronne (1992) et le musée archéologique de l’Arles antique (1995), ou encore le palais de justice de Pontoise (2005). Entre autres distinctions, il reçoit en 1983 le Grand Prix national de l’architecture et l’Équerre d’argent ; en 2021, le Grand Prix d’architecture lui est décerné par l’Académie des beaux-arts.
De sa carrière d’enseignant, qu’il entame dès la fin des années 1960 au sein d’UP7 à l’invitation d’André Gomis, et qu’il poursuit à partir de 1978 à UP8 (devenue l’Ensa de Paris-Belleville en 1984), accueilli par l’architecte Bernard Huet (1932-2001), on retient la pédagogie qu’il y a développée au sein du groupe UNO, cofondé avec trois autres architectes-enseignants, Jean-Patrick Fortin, Édith Girard et Claude Vié, rejoints rapidement par Laurent Salomon, plus tard par Alain Dervieux. Et bien d’autres. Ce groupe singulier, dont « la pédagogie est basée sur une théorie du projet et de l’espace de l’architecture – un espace pluriel : artistique, urbain, architectural, sociologique –, qui s’appuie principalement sur les œuvres du Mouvement moderne », raconte Alain Dervieux, attire de nombreux étudiants français et étrangers. Animé par une pensée sociale, l’enseignement d’UNO suit une progression qui va du logis à la pièce urbaine, le logement étant vu comme « la brique de base du travail de la pièce urbaine », peut-on lire dans un entretien de Ciriani publié en 1985 (cf. https://henriciriani.blogspot.com/search/label/enseignement). « En introduisant, un semestre sur les grands édifices publics comme composants de la ville, de l’espace urbain, Ciriani a aussi permis à ses étudiants de répondre à ce type de programme », complète Jean-Patrick Fortin.
Si le béton a souvent été sa matière, c’est la question de la pérennité et de l’obsolescence qui intéresse l’architecte comme l’enseignant : « Il faut définir les lieux réceptacles de la lumière naturelle, de telle sorte que, devenues fixes, ces matières opaques soient peu soumises aux changements futurs. Les parties transparentes […] vont assurer l’éphémère, l’obsolète […] » (cf. https://henriciriani.blogspot.com/search/label/enseigner).
-
Actualités
-
Actualités
-
Impression béton 3D - Bâtiment
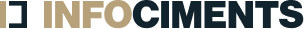


COMMENTAIRES
LAISSER UN COMMENTAIRE